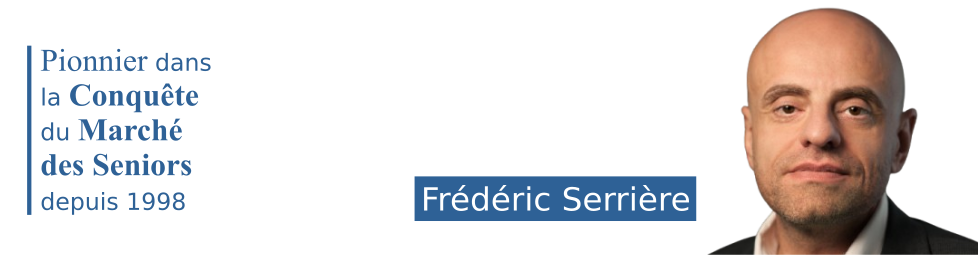Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics ainsi que divers organismes de financement, comme les caisses de retraite, coorganisent et financent des actions de prévention destinées aux jeunes seniors, principalement âgés de 60 à 70 ans.
Ces actions couvrent un large éventail de thématiques, allant de l’activité physique adaptée à la prévention des chutes, en passant par la protection de la mémoire, l’alimentation ou encore la conduite automobile. L’objectif est clair : prévenir la perte d’autonomie en encourageant des comportements adaptés et préventifs.
Cependant, une question demeure : ces actions de prévention touchent-elles réellement les populations les plus à risque ?
Un public majoritairement déjà sensibilisé
En analysant les profils des participants à ces programmes, on observe qu’environ 80 % d’entre eux sont déjà convaincus par la prévention. Ils adoptent déjà des comportements sains et viennent chercher des informations supplémentaires pour optimiser leur mode de vie. Le second profil, représentant environ 20 % des participants, regroupe des personnes ayant récemment connu un problème de santé (diagnostic de diabète, cancer, etc.) et qui cherchent des solutions pour limiter les complications.
Ainsi, la grande majorité des personnes les plus éloignées de la prévention – celles qui ignorent ou repoussent les comportements bénéfiques – ne sont pas atteintes par ces actions. Ces individus, qui représentent environ 82 % de la population concernée, adoptent soit une posture de déni, soit une attitude de procrastination face aux enjeux de santé.
Un investissement sociétal limité
Les actions de prévention actuelles échouent donc à attirer les publics les plus à risque, ce qui réduit leur impact à l’échelle sociétale. L’idéal serait de toucher les individus qui ont le plus besoin de modifier leurs comportements, mais ces derniers sont difficiles à convaincre. Contrairement aux convaincus naturels de la prévention, ces personnes ne sont pas réceptives aux campagnes institutionnelles et ont tendance à remettre à plus tard les changements nécessaires.
Quelles solutions pour toucher un public plus large ?
- Le rôle des professionnels de santé Les campagnes de prévention ont plus d’impact lorsqu’elles sont portées par des médecins ou des professionnels de santé. Une consultation médicale, où un praticien explique les conséquences immédiates d’un comportement à risque (prise de médicaments, hospitalisation possible, etc.), peut être plus convaincante qu’une communication générale.
- Miser sur les bénéfices secondaires Plutôt que de présenter la prévention comme une obligation, il faudrait intégrer des bénéfices immédiats et attractifs. Par exemple, dans le cas de l’activité physique, insister sur la convivialité des sessions sportives (plutôt que sur la prévention des chutes) peut inciter davantage de personnes à s’engager sur la durée.
- Revoir la stratégie de communication Les messages axés sur la peur à long terme (perte d’autonomie, maladie chronique) sont peu efficaces sur ce public. En revanche, des messages centrés sur des gains immédiats (meilleure énergie, sommeil amélioré, interactions sociales enrichies) ont plus de chances de susciter l’intérêt.
- Assurer la pérennité des comportements adoptés Une étude récente (2024) portant sur des programmes d’enrichissement alimentaire en Norvège, Grande-Bretagne et France a montré qu’après avoir suivi une formation sur l’ajout de protéines dans l’alimentation, seulement 15 % des participants étaient certains de poursuivre cette pratique. Cela illustre la difficulté de transformer une prise de conscience ponctuelle en habitude durable.
Conclusion
Les actions de prévention destinées aux jeunes seniors sont utiles mais insuffisantes dans leur forme actuelle.
Elles attirent majoritairement des individus déjà convaincus et manquent leur cible principale : ceux qui ne pratiquent pas encore la prévention. Pour améliorer leur impact, elles doivent intégrer des stratégies plus engageantes, s’appuyer sur les professionnels de santé et proposer des bénéfices secondaires attractifs. Il ne suffit pas de présenter la prévention comme une solution pour demain ; elle doit devenir un avantage immédiat, tangible et intéressant aujourd’hui.
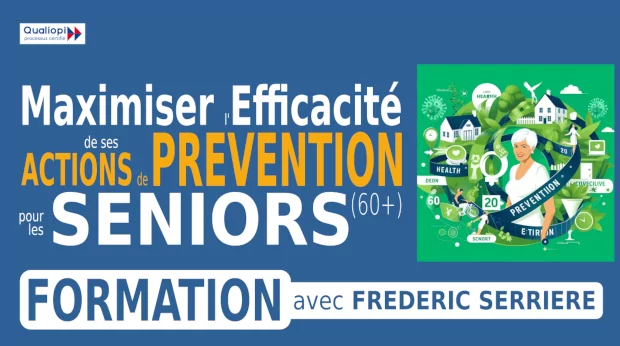
NEWSLETTER
Recevez chaque semaine la newsletter AgeEconomie et l'émission Le Grand Entretien
EMISSION LE GRAND ENTRETIEN
Le site de l'émission (vidéos et replays)